Mes Ouvrages
Laurence Martin Auteure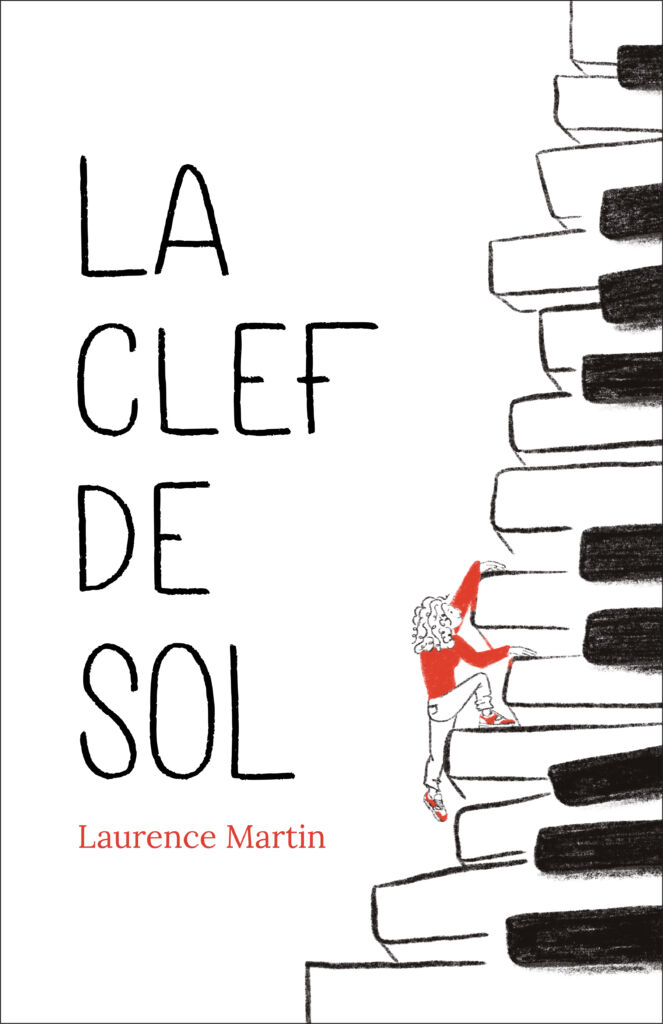
1989. Lorsque Pierre retrouve Nadia aux funérailles de son ex-épouse, les deux se reconnaissent sans échanger un mot. Vingt ans les séparent de leur dernière entrevue. Le père, à la corpulence imposante, a simplement vieilli. La fille, au profil grave, est devenue une célèbre cantatrice. Nadia a trente ans, elle attend un enfant, seule, et ne tardera pas à reprendre contact avec son père.
À la naissance de Soledad, sa petite-fille, Pierre, émerveillé, bascule dans un nouveau rôle. En grandissant, la fillette se révèle différente. Là où les autres enfants s’approprient le langage avec aisance, la petite cherche un chemin vers les mots. Nadia ne l’acceptera pas. Pierre deviendra le papi de tous les jours, de tous les instants, de tous les chagrins, comme de toutes les joies.
Entre le grand-père et sa petite-fille se crée un lien indéfectible, au cœur duquel la musique et le piano prennent une place centrale. Il faudra des années de persévérance et la force de l’amour pour que chacun accomplisse sa transformation et mette au jour ses désirs.
L’homme avait garé sa voiture, il avançait maintenant à pied, le visage sombre, le pas traînant, les poings serrés au fond des poches. Il ne voulait pas rattraper le retard volontairement pris. Il escomptait qu’en arrivant le parvis serait débarrassé de l’attroupement qui s’y trouverait et lavé des conversations dont il fuyait systématiquement la vacuité. L’homme s’appelait Pierre et il marchait, mécaniquement, l’esprit absent. Mobilisé par la douleur, son corps avançait malgré lui. Quiconque l’aurait croisé ainsi, blotti dans d’obscures réflexions, se serait décalé d’un pas pour ne pas être bousculé. Il faut dire que sa haute stature, doublée d’une carrure imposante, n’engageait pas à la rencontre.
Pierre se rendait à Saint-Sulpice, aux funérailles de Marina. Son ex-femme s’était éteinte six jours plus tôt à l’hôpital et, sans l’appel d’une connaissance, qui leur était encore commune, aucun faire-part n’aurait prévenu de la date et du lieu de la cérémonie.
Le glas sonnait lorsqu’il entra et se signa machinalement. En passant le seuil de l’église, l’odeur des lys et de l’encens l’incommoda immédiatement, tandis que sa vue s’adaptait à la pénombre de l’endroit. L’édifice avait la beauté de ces lieux saints où l’ornement unit le sacré au mystique.
Pierre se dirigea vers la nef et se choisit un banc discret, à moitié vide, au dernier rang. Il contorsionna sa carcasse pour s’installer auprès des autres, dépassant d’une tête l’assistance. La musique provenant du grand orgue provoqua le long de ses bras un frisson incontrôlable, et l’Ave Maria de Schubert noua sa gorge d’un sanglot. Il avait tant aimé cette femme.
Ses mains carrées, aux veines saillantes, s’entrelacèrent dans la prière, mais on pouvait voir qu’elles tremblaient. Les souvenirs envahirent sa tête. Il exhuma de sa mémoire de nombreuses images du passé, et se souvint distinctement du rire enjoué de Marina au jour de leur première rencontre. Puis l’organiste s’interrompit. La résonance de l’instrument retint encore quelques secondes le son des notes qui faiblissaient avant que le silence ne retombe. L’abbé rejoignit le micro dans le craquement sourd de la chaire alors que Pierre revenait à lui. Déjà son regard fourrageait, remontait la nef jusqu’au chœur, scrutant chaque visage, chaque silhouette comme s’il convoitait le Saint Graal. Où était-elle ? /Où la trouver ? Enfin, il s’immobilisa, le cœur battant, le souffle court. Elle s’offrait telle une toile de maître dans le clair-obscur des bougies, un trésor qu’il aurait perdu et venait juste de recouvrer. Cela faisait près de vingt-cinq ans qu’il n’avait pas revu Nadia. La jeune femme enterrait sa mère, mais elle se tenait droite et digne dans l’immobilité du corps, l’impassibilité du trait. Le teint diaphane, le profil grave, à gauche du cercueil maternel, elle semblait entre parenthèses. Un chignon danseuse enserrait sa longue chevelure d’un blond solaire, dont la couleur faisait offense à ce parterre de noir vêtu. Entendait-elle seulement le prêtre, le froissement léger des mouchoirs, l’écho des sanglots étouffés ? L’unique mouvement répétitif que la jeune femme s’autorisait était de caresser son ventre où pointait l’enfant qu’elle portait. Puis, dans un mouvement contrôlé, elle se tourna vers l’assemblée, comme si le regard de cet homme, fixement posé sur sa nuque, avait réveillé un instinct. Elle le reconnut sur-le-champ. Pierre affichait cette même posture embarrassée et imposante qu’elle lui avait connue enfant. Non, son père n’avait pas changé, il avait simplement vieilli.
Elle lui fit un signe de tête. Il le lui rendit, ce fut tout. Pas un sourire et pas un geste, le simple regret des années, la gêne de ne pas se connaître, l’abîme entre eux, irréversible. Avant que l’office ne prenne fin, Pierre s’éclipsa sans être vu ni aller bénir le cercueil. Ses adieux, il les ferait ailleurs, dans la solitude de son cœur, dans les méandres de la musique. Il s’installerait face au piano et jouerait pour Marina tous les airs qu’elle avait aimés. Ainsi lui rendrait-il hommage, ainsi la laisserait-il partir.
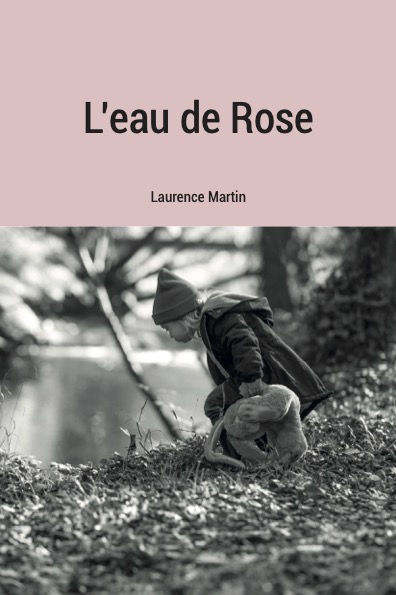
Elle me pointe un petit carnet qui gît le long du caniveau et murmure – Dites-leur pour moi que je les aime
Je demande
– À qui ? elle convulse.
Je pleure
– À qui ? elle est partie.
La femme qui sortait du cimetière est venue mourir dans mes bras… Je souffle « Je le leur dirai » comme une promesse indestructible.
Rose ne sait pas que cette promesse va bouleverser son existence.
Au fil des pages de ce carnet, elle remettra en question sa solitude.
Elle ira chercher ses réponses, contestera les lois familiales qui érigent le silence sur sa mère disparue il y a vingt ans. Elle apprendra combien la vie peut être belle et l’amour un nouveau départ.
Mais, quand l’adversité s’entête, la peur reprend parfois ses droits et la mort ses prérogatives.
Rose trouvera-t-elle sa vérité ?
Osera-t-elle enfin le bonheur ?
Je m’appelle Rose, j’ai 22 ans, je ne connais pas le bonheur. En revanche, j’aime le regarder, le toucher du doigt, l’approcher, pour cela, j’ai mes habitudes.
Chaque soir, la même sortie d’école, la même petite fille, et j’attends. J’attends ce flot de bonheur rare, cette jubilation enfantine, ce trépignement intérieur que je n’ai jamais ressenti. Je plonge dans son regard inquiet, je la regarde scruter la foule, chercher sa mère dans l’assistance. J’attends l’instant où elle la voit, celui où elle lui fait un signe, où son visage, soudain, s’allume, et ses prunelles se font plus grandes. On peut tout voir dans un regard, même un cœur éclater de joie. Puis je l’observe supplier la permission de s’en aller et courir droit, sans s’arrêter, jusque dans les bras maternels.
Quand l’école ferme pour les vacances, c’est dans les gares que je le cherche ; le bonheur traîne au bout des quais. Souvent, c’est une femme qui l’arbore. Sur une femme, c’est plus repérable. Elle arrive sous le tableau noir, fouille
la liste des arrivées, mordille ses lèvres, cherche le quai, fait les cent pas et s’impatiente, regarde sa montre, arrange son col. Puis finalement, le train arrive, les gens descendent, la femme s’approche. Elle se hisse sur la pointe de ses pieds, s’agrandit, contorsionne son corps, affronte la foule qui la menace. Enfin, elle le voit, il est là, elle aussi, elle court droit vers lui, pour elle aussi, le même regard, le même son du cœur qui éclate. Elle court, et il ouvre les bras. Le temps suspend son triste vol chaque fois que les amants s’embrassent, peu importe qu’ils soient bousculés, houspillés de « pardon » pressés, fustigés de regards jaloux, ils sont heureux et seuls au monde.
Ça doit être ça, le bonheur, sentir les battements de son cœur accélérer dans sa poitrine, avoir l’impression qu’il éclate, qu’il inonde son corps de chaleur jusqu’au plus petit des recoins. Peut-être l’ai-je vécu un jour. Mais c’est si loin que je ne sais plus.
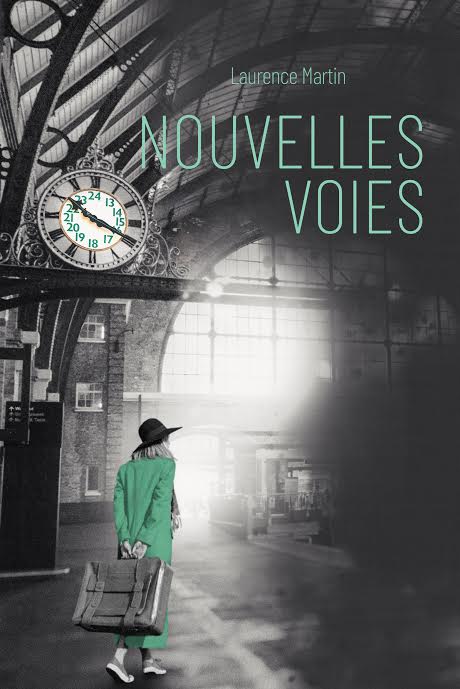
Pour quelles raisons partiriez-vous ?
Quelle autre vie ? Quelles nouvelles voies ?
Vous décideriez-vous dans l’heure ou prendriez-vous votre temps ?
Voici le récit de départs irréfléchis ou orchestrés, volontaires, subis ou rêvés… définitifs, libérateurs.
Au travers de ces dix nouvelles, l’auteure vous invite à suivre des personnages en quête d’un autre destin.
Nouvelle « MA CHANCE »
Je m’appelais Sagar, ce qui signifie « océan » dans ma langue natale… Mais je n’ai jamais su pourquoi. Mes parents, sans doute, aimaient-ils les grandes étendues d’eau salée. Avaient-ils été voir la mer, celle que l’on nomme « d’Arabie », qui s’étend d’Oman à Bombay ? Je ne garde aucun souvenir d’eux… Juste une impression très fugace de vivre entouré d’animaux. Je sais seulement qu’ils ont péri dans l’incendie de leur maison. Je suis né le six avril 1994 à Sangli dans l’état indien du Maharashtra, mais là encore, rien n’est certain. Ai-je deux ans de plus ou de moins ? Mystère qui restera entier. Qu’importe, ma vie est ainsi faite de questions souvent sans réponses et mon esprit a tout tenté pour gommer ce passé lointain. J’ai proscrit, oublié, lâché et ne me suis pas retourné… Ma langue, mon prénom, mon histoire, je ne voulais plus en parler. Pourtant, ce tout petit garçon sur le cliché en noir et blanc qui tente d’esquisser un sourire, c’est moi, c’est Sagar l’orphelin. Ce regard tendre, ces joues renflées, ces yeux qui dévorent mon visage et cette chemise à petits pois sans doute portée pour l’occasion, c’est la seule photo qu’il me reste du temps d’avant… Avant ma chance.

